 Les derniers jours de décembre étant d’ordinaire l’occasion de tirer le bilan de l’année écoulée, je profite de l’occasion pour jeter un coup d’œil sur l’année 2017.
Les derniers jours de décembre étant d’ordinaire l’occasion de tirer le bilan de l’année écoulée, je profite de l’occasion pour jeter un coup d’œil sur l’année 2017.
Là, je sens que je vais vous surprendre : c’est en 2017 que j’ai découvert que le diabète du 1er type, que je fréquente pourtant depuis plus de 25 ans, était une maladie grave. Sans rire.
Déjà, je n’étais pas bien sûre qu’il s’agissait d’une maladie, au sens de vraie maladie. Combien de fois en effet me suis-je entendu dire : « Mais enfin… vous n’avez pas l’air malade ! ». À cette époque, je n’avais pas la présence d’esprit de répondre « Ah oui ? Eh bien, les apparences sont parfois trompeuses : vous, par exemple, vous n’avez pas l’air d’être un sombre crétin ». Il faut dire aussi que j’avais 11 ans lors du diagnostic, l’esprit de répartie ne m’est venu que plus tard.
Dès l’annonce de la maladie – que l’endocrino pédiatrique avait soigneusement omis de me signaler comme incurable. C’est la pauvre infirmière qui a dû se taper le sale boulot quand, au bout de quatre jours, j’ai fini par demander quand j’allais guérir – j’ai été ensevelie sous les « Mais on vit très bien avec ça maintenant ! », « Ça n’empêche absolument pas d’avoir une vie normale », « Il y a tellement plus grave ! », « La maladie, c’est une épreuve qui nous fait grandir, tu verras, tu finiras par lui être reconnaissante ».
Peut-être y a-t-il des enfants, ou même des adultes, que ces propos rassurent ou réconfortent. Après tout, il paraît qu’il y a aussi des gens qui entendent les couleurs. Dans mon cas cependant, et je crains qu’il soit loin d’être isolé, ils ont eu l’effet d’une pure et simple injonction au silence. Quelques années plus tard, durant lesquelles mon HbA1C s’est essentiellement distinguée par sa capacité à adhérer au plafond et mon endocrinologue par la profondeur de ses soupirs de découragement, j’ai bouclé ma maîtrise et envisagé de passer les concours de l’éducation nationale. En fait, je voulais plutôt faire médecine, mais l’endocrino précédent avait cru bon de me prévenir que ce serait vraiment très difficile avec ma (non-)maladie, alors que prof, c’était parfait : des horaires de fonctionnaire, beaucoup de vacances, pas de stress ni de responsabilités (authentique !). Pas besoin de mentionner les réductions à la CAMIF et le salaire mirobolant, j’étais déjà convaincue. Non pas que le métier de prof était fait pour moi, mais plutôt que j’étais un déchet social à qui le type de profession qu’il exerçait était inaccessible. Là encore, la capacité d’envoyer paître les abrutis me faisait cruellement défaut.
En vue des épreuves du CAPES et de l’agrégation, j’ai demandé à bénéficier d’un tiers-temps, histoire d’avoir le temps, si besoin, de remettre mes neurones en état de marche, en cas d’hypo ou d’hyper. Ceci m’a donné l’opportunité extraordinaire de rencontrer le médecin du rectorat qui, arrivé avec deux heures de retard, a beuglé depuis sa chaise de bureau, par la porte donnant sur la salle d’attente : « Le diabète ! ». Comme « Le sourd » à ma gauche n’avait rien entendu, et que « La sclérose latérale amyotrophique » assise à droite ne mouftait pas, je me suis présentée devant celui qui aurait mérité pour sa part le titre de « L’imbécile chronique boursoufflé d’incompétence aiguë ». La consultation fut mémorable : « Mais enfin, pourquoi vous demandez un tiers-temps ? Le diabète, c’est pas une maladie. Moi, le fils de mon meilleur ami, il est diabétique : eh ben il fait du sport. Et puis, pour passer une agrégation à votre âge, vous allez pas me dire que vous êtes bien malade. C’est dans la tête tout ça. » Tiers-temps refusé. En ce temps-là, j’ignorais encore la belle langue du Québec et cette expression aussi pittoresque qu’adéquate en pareilles circonstances : « Mange donc un char de marde ».
Quel rapport avec la maladie grave ? J’y viens. En mars 2017, j’ai lu le dernier livre de Ruwen Ogien, Mes Milles et Une Nuits. Je connaissais l’auteur pour l’avoir croisé à quelques reprises, et je le savais atteint d’un cancer. Il est décédé quelques semaines plus tard. C’est dans son livre que j’ai lu, pour la première fois, que le diabète était une maladie grave. C’était écrit comme ça, noir sur blanc, comme une évidence, sans détour ni note de bas de page précisant que non, en fait, il ne faut pas exagérer, à moins d’être atteint de toutes les complications disponibles, le diabète n’est pas vraiment une maladie grave, restons raisonnables. Quand on me demande si ce que j’ai « est grave », je réponds systématiquement que non-non, je minimise, je positive, tant et si bien qu’à la fin, l’interlocuteur est presque tenté de se commander un DT1 direct sur Amazon tellement que ça a l’air bien. Syndrôme de Stockholm ?
D’après Ogien, l’explication serait plus sociale que psychologique. Il réfléchit ainsi au « rôle (social) » du malade. Être malade, explique-t-il en substance, ce n’est pas la même chose qu’avoir le droit d’être malade. Et on peut bien être malade sans se voir reconnu le droit de l’être, ni même se le reconnaître. Les malades, surtout s’ils n’ont pas le bon goût d’en avoir l’air, sont par défaut toujours suspectés de ne pas l’être, ou de l’être moins que ce qu’ils en disent, et de chercher à tirer bénéfice de leur soi-disant maladie.
Ogien résume :
« Pour nous convaincre de son innocence, le malade doit donc construire une mise en scène dont les éléments principaux sont les suivants.
1) Montrer par des mots et des actes que, s’il ne peut pas remplir ses devoirs économiques et sociaux, ce n’est pas par paresse ou absence de motivation, mais parce que son état de santé défectueux l’en empêche sans contestation possible.
2) Montrer par des mots et des actes qu’il n’est absolument pas responsable de cet état de santé (il a pris toutes les précautions qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui, etc.).
3) Montrer par des mots et des actes qu’il fait tout ce qui est en son pouvoir pour retrouver sa santé et reprendre en charge ses devoirs économiques et sociaux. Il est dans l’obligation de signifier aux autres qu’il trouve son état indésirable et qu’il obéit sagement à certaines injonctions comme celle de « rester au lit » pour ne pas aggraver son cas. Il doit transmettre l’impression qu’il ne pourrait absolument pas s’en tirer par un acte de volonté, c’est-à-dire qu’il ne pourrait pas décider de ne plus être malade. Il doit donner des signes du fait qu’il recherche sincèrement et activement l’aide d’un technicien compétent (un médecin généraliste ou spécialisé) et qu’il s’engage à coopérer avec lui pour essayer d’en sortir.
Cette mise en scène définit le rôle social de malade. » (p.129-130)
En lisant ces lignes, j’ai été frappée par la justesse avec laquelle elles s’appliquent à la situation d’un diabétique de type 1, et montrent que la spécificité de cette pathologie, chronique et incurable, le place dans une position impossible. Au regard de la première condition, on lui reprochera immanquablement de ne pas mener la « vie normale » et productive qu’un traitement bien suivi est censé lui assurer. Ai-je donc été la seule adolescente à me rouler en boule avec des idées de suicide après avoir lu, dans le bulletin de l’AJD, les témoignages de ces héros et héroïnes du diabète de type 1, en train de terminer leur internat en chirurgie cardiaque sans jamais une hypo ni une hyper, ou de préparer leur quatrième Iron Man au Guatemala ? État de santé défectueux vous dites ? C’est juste une question d’organisation. Ou de volonté. Bref, ces choses dont vous, qui êtes loin d’en faire autant, êtes manifestement dépourvus.
La deuxième clause me paraît encore plus difficile à satisfaire : à partir du moment où il commence l’insuline, le diabétique de type 1 est tenu pour premier, voire seul responsable de son état de santé : n’est-ce pas lui qui, non seulement s’administre, mais encore décide du traitement ? Un diabète « déséquilibré », c’est le signe d’un traitement mal suivi ou de « compétences » mal maîtrisées : une alimentation anarchique, ne sait pas calculer correctement les glucides, est trop « indiscipliné », ne pense pas à faire la rotation des sites d’injections, n’anticipe pas correctement les effets de l’activité physique/ du stress/ du rhume/ de la couleur de ses bretelles sur la glycémie. Un jour où je confiais à une infirmière clinicienne que les injections de Lantus me faisaient mal, la réponse ne s’est pas fait attendre : « Ah, alors là c’est la technique d’injection qu’il faut revoir. Vous n’êtes pas censée avoir mal. Les aiguilles sont tellement fines maintenant, on ne sent plus rien. » C’est vrai ça, il est écrit « indolore » sur les publicités, vous allez quand même pas me dire le contraire. Et puis, franchement, ça ne peut pas faire mal, puisque, au fond, tout ça, c’est du soin (ça ne peut pas être mauvais : c’est du médicament !).
Enfin, il y a l’impératif d’être un bon diabétique, qui veut aller bien, et se doit donc d’être un bon patient, volontaire, positif, proactif (on aime beaucoup cette expression en Amérique du Nord). À défaut d’être « observant » dans sa vie quotidienne et de rendre des comptes à la hiérarchie morale et médicale, qu’au moins il se taise, se contente d’acquiescer à ce qu’on lui dit (« On va vous passer de 4 injections à 5 par jour. De toute façon, une de plus ou une de moins, pour vous, ça ne change pas grand’ chose. »), et qu’on n’en entende plus parler. Malade chronique, et diabétique de type 1, vous êtes présumé coupable, et tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Par les représentants de l’ordre social, mais aussi, ce qui est peut-être le pire, par vos proches, et par vous-même : d’où la manière dont, je crois, nous acceptons de ne pas être entendus, et renonçons même à nous faire entendre. Car, après tout, on l’a bien appris et compris, le diabète de type 1 n’est pas une maladie grave…
Référence : Ruwen Ogien, Mes Milles et Nuits – La maladie comme drame et comme comédie, Paris, Albin Michel, 2017



 Frédérique Georges-Pichot
Frédérique Georges-Pichot
 Anne Durand
Anne Durand Juliette de Salle
Juliette de Salle




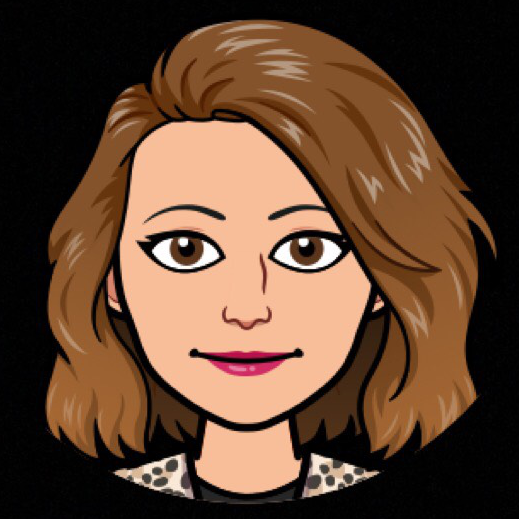














Diane Gagnon
J’admire ma fille de vivre chaque jour avec cette maladie grave. Pas facile tous les jours avec les variantes essaie-échec, essais-bon résultat mais pour combien de temps. Avec cette maladie rien n’est acquis. Vivre au quotidien c’est tout un défi. Je me souviens lorsque mon mari est décédé elle a vécue une grande peine. M.DIABETE a fait des siennes…..
Bertrand Burgalat
Bonjour Diane. Voulez-vous dire que votre fille est devenue diabétique peu de temps après la mort de son père? Nous sommes nombreux à être devenus diabétiques dans un contexte psychologique difficile, ou à la suite d’un vaccin, mais ces facteurs ne sont jamais pris en compte dans le déclenchement de la maladie, qui reste toujours bien mystérieuse. Cela sera difficile de la guérir tant qu’on n’aura pas compris ses causes.
JEAN-YVES
Bonjour,
J’ai 57 ans et suis devenu D1 après un vaccin anti variolique. On me l’a fait 3 fois sans qu’il ne prenne. La 4ème vaccination a prise… 15 jours + tard, les symptômes apparaissaient. Tous les D1 que je connais je sont devenus après un choc physique ou émotionnel. Le vaccin c’est physique. Les décès relèvent de l’émotionnel. Idem pour un accident de voiture qui conjugue les 2 types de chocs.
JEAN-YVES
Je précise que je le suis devenu à 9 ans
J’en ai 57.
Bertrand Burgalat
Cher Jean-Yves, merci pour ce témoignage, je commençais à croire que j’étais la seule personne au monde à être devenue diabétique quelques semaines après ce vaccin… Aucun rapprochement, ni à l’époque ni plus tard, mais le vaccin avait ensuite été supprimé sans bruit si je m’en souviens bien…
MARECHAL
Ma grande soeur est diabétique. Nous parlons peu de sa maladie. Mon soutient n’est pas terrible car je veux la protéger mais ce n’est pas ça qu’elle veut de ma part je pense. J’admire son courage pour affronter le diabète. Je me dis toujours que si ma soeur a le sourire et bien je ne peux que l’avoir à mon tour. On ne se rend pas compte de ce que représente la maladie si nous ne sommes touchés directement, car le voir ce n’est pas le vivre. Merci pour cet article
Matthieu
Mon « diagnostique » a eu lieu un 6 Juin 1996, un jour d’été après un printemps radieux. J’avais 10 ans, évidemment j’avais maigri, évidemment j’étais bien plus faible et souffrais des symptômes standards entre soif, polyurie, cétonurie (limité toutefois).
J’ai eu la chance, car c’est une chance, d’être bien diagnostiqué et entouré, d’avoir des médecins non pas compétent car, n’en déplaise, on s’en fiche quand on a un type 1 (la compétence ne dose pas mieux l’insuline), mais humains.
La chance d’avoir une famille qui, inquiète a toutefois réussi à ne pas me faire ressentir inutilement cette inquiétude afin que l’enfant que j’étais n’en porte pas seul le poids.
Un père qui, je ne sais plus quand, un ou deux ans plus tard alors que je faisais un malaise et paniquais m’a dit « ce n’est pas à toi de t’adapter à la maladie mais à elle de s’adapter à toi ».
Nous étions en 97, l’insulino-thérapie fonctionnelle n’exsitait pas formellement mais je la pratique depuis ce jour. A ma connaissance cette phrase de mon père est la seule formation que j’ai reçu, j’exagère bien-entendu, mais c’est la seule qui m’ait donnée la force de compter et faire attention.
Comme quoi…
Revenons en 96, en Juin j’arrive à l’hôpital de Tulle par mes (nos) propres moyens, il fait chaud, j’ai le souvenir d’une luminosité aveuglante partout, tout le temps pourtant c’est la fin d’après-midi. Salle d’attente, ma mère me donne de l’eau, encore de l’eau…
Les médecins arrivent, une salle d’auscultation, un pédiatre et un endocrinologue (qui me suit encore). Le couperet, il n’y a plus de lumière. Plus d’été, des mots, précis, pas transigeant, j’ai une pathologie, chronique qui ne peut être soigné que par injection, sa vie durant, mais il est possible de bien vivre et même normalement.
On m’a dit tous cela le premier jour, c’est important, je crois… Je crois que c’est important de dire, même à un enfant en état de choc, la vérité et réalité.
Puis le traitement, voie centrale, j’avais une peur bleu des aiguilles, une pompe à insuline en forme de pompe à morphine (un truc maousse branché sur secteur)… Je crois que c’est là que j’ai réellement été « choqué ».
Ensuite dix jours d’hospitalisation, c’est long… Mais déjà je comprends rétrospectivement que je n’étais pas du genre à savoir mourir. Je passe mon temps à chercher de quoi lire, jouer, relire, écrire, dessiner, jouer encore… Il faut que j’occupe mon esprit, parce qu’en fait, je suis en train d’apprendre à dix ans à mourir. Évidement je ne le suis pas, mort, et ne comptait ni ne compte l’être mais je comprends alors que c’est « possible », ce que je ne concevais pas quelque jours avant…
Comment réagit-on ? Qu’est ce qui fait que certain.e s’en sorte mieux ?
Franchement ? Je n’en sais rien je ne sais que ce qui m’est arrivé et pour certaine bride de souvenir il m’a fallu 20 ans pour les rassembler et comprendre.
Revenons en 96, les 9 jours suivants, le soleil est revenus et s’est levé, je m’occupe tant et si bien que je ne pense que très peu à la maladie. J’ai confiance, ai-je le choix de toute façon ? Non, alors je me laisse porter mais je sais que j’ai beaucoup pleurer, mais je n’arrive plus à me souvenir des déclencheurs précis…
Enfin, si, je ne pouvais faire, manger ce que je voulais ou comme je voulais…
Et il y’a Yann, en fait je ne sais pas si c’est son prénom, un enfant qui est là aussi et a plus ou moins mon âge et qui semble aussi actif que moi alors… On s’amuse ensemble.
Son père, un jour, est là et me demande sans détour ni arrière pensé ce qu’il m’arrive et pourquoi je suis là. Je lui répond que c’est le diabète de type un. Je revois son visage et celui de son fils, il me réponds quelque chose qui dit « c’est dur mais au moins ça se soigne ».
Je pensais que mon diabète était gravissime et lui me sors ça… Mon cerveaux de gamin a du turbiner car j’ai compris, consciemment, des années plus tard que son fils devait être mourant… Contrairement à moi.
Le reste est flou mais il y’a deux éléments qui ont forgé mon rapport à la maladie et son effet sur mon caractère.
Le premier est un élément troublant, l’hôpital est construit à flan de colline et les étages du rdc au 5ième ont tous un accès/rdv coté colline, ma chambre donne coté colline, spacieuse dans mon souvenir, je vois le soleil se coucher dans l’enfilade du couloir qui longe donc la colline et je vois les feuilles des arbres. Et cette pensée se fige, fixe, grave en moi comme une évidence. Je pense aux siècles qui ont conduit cet arbre à être ce qu’il est, je pense aux autres arbres, aux forêts, à ces cycles et saison qui alterne et font le monde tel qu’il est (tel que le percevais l’enfant des bois né en Corrèze que j’étais à 10 ans), les bourgeons, les feuilles, l’automne… Et cet évidence qui éclate dans ma tête : tous ça, oui tous ça existera même si je ne suis plus là. Toute cette beauté et éternité cyclique continuera même si je disparait… Et je crois que je me suis senti tellement bien que j’ai dormi ce jour là comme une souche pour la première fois depuis mon entrée.
J’ignore pourquoi mais j’ai ressentit un tel apaisement qu’encore aujourd’hui c’est cette pensée qui me (sup)porte quand je vais mal et vois le monde devenir fou… Aujourd’hui je pense qu’on a tou.te.s ce genre de « madeleine » et qu’il est plus important que tout de s’en construire une même si… Je suis le premier à savoir qu’elle se trouve généralement dans la douleur.
Le second est un truc que j’ai découvert à 30 ans… Un film, peut être certain.es l’ont vu : « Bienvenue à Gattaca », je ne reviendrai pas sur le thème et sujet du film mais qu’on fait fasse à un diagnostique d’un type 1 disons qu’il nous parle beaucoup.
Bha voilà, j’ai vu ce film avec le gamin que j’évoquai plus haut et, évidemment, il m’a beaucoup marqué surtout cette idée que notre force réside dans la tête/pensé et que nos gènes ne détermineront pas tous.
Là vous vous dites : « Bon ok, déjà le gars c’était farfelu avant ce qu’il écris mais là c’est juste nul ».
Bha le farfelu c’est qu’un jour à 30 ans j’ai voulu aller revoir la fiche du film, voir ce qui s’était dit dessus depuis ect…
Souvenez vous, nous somme en Juin 1996….
…
Le film est sorti outre Atlantique mi-1997, j’ignore totalement sa date de sorti en France… Après m’être creusé la tête/mémoire je pense que j’ai vu ce film lors de ma seconde hospitalisation pour changer de traitement (passé un schéma 2 +1 correction midi à basale bolus) en 2000. Mais aussi vrai que j’ai vu mon voisin ce matin j’ai vu ce film en Juin 1996 ce qui veut dire que mon inconscient a fait un travail étonnant pour faire réaliser un voyage dans (mon)le temps à ce film… Pour mon plus grand bien en fait.
Après pour ce qui est de la maladie elle-même j’ai vu l’évolution au début des années 2000, l’apparition des stylos jetables et aiguilles fines (en 1996 c’était 40u/ml et des seringue avec aiguille de 10-12 mm…). Aujourd’hui il est possible d’adapter ses doses sans tenir compte d’hypo/hyper-glycémie post-post-prandiale (heu, oui, avant une insuline « rapide » c’était 6 à 8 d’action et pic autour de 3-3h30… L’Humalog a définitivement changer la vie des diabétiques), de voyager sans trop de migraine (nos amis de type 2 sous insuline étant devenus nombreux les aéroports commencent à s’habituer, un truc : les stylos jetables entièrement en plastique se garde bien sur soi au passage des portiques, ça fait gagner du temps), faire du sport pour le sport et son plaisir (et non pour le diabète !)… Bref, l’important est de se connaitre et vivre avec et non pour la maladie.
Et si un médecin sort des âneries, c’est qu’il est temps d’en changer (je me souviens, à mon installation à Lyon, d’un généraliste qui, face à mes soucis de digestion d’alors et visiblement impressionné par le fait que je vive depuis 20 ans avec un diabète me sors : « Ha ça, c’est la gastro-parésie M. ! » Heu… Finalement après avoir arrêter le lait et un traitement anti-spasmodique de quelque mois ça va mieux…
Qui sait, le gars a peut être trouver un traitement révolutionnaire sans le savoir (ironie).
Bien à vous,
Matthieu