 Tout récit aurait un début et, parfois, une fin. C’est ce qu’on apprend et observe sur de (trop ?) nombreux écrans. On nous apprend ensuite et aussi que le début est au passé.
Tout récit aurait un début et, parfois, une fin. C’est ce qu’on apprend et observe sur de (trop ?) nombreux écrans. On nous apprend ensuite et aussi que le début est au passé.
Il faut que je vous fasse une confidence : j’ai hésité à suivre machinalement cette règle. En fait, voyez-vous, le fait est que, même sans DeLorean nucléaire, le voyage dans le temps existe.
Sauf que l’on nomme cela communément « mémoire ». Et, trop souvent, on aimerait la voir fonctionner comme celle d’un ordinateur.
Eté 2018 – Un présent comme d’autres jours
Examen de routine à l’hôpital de Tulle, cela fait cinq ans que je n’y ai mis les pieds et probablement plus d’un an que je n’ai vu aucun médecin. Juste besoin d’un certificat que pour des raisons pratiques mais surtout personnelles je préfère aller chercher là.
Sans doute aussi un besoin d’humanité loin des usines médicales urbaines. Rien de spécial sous le soleil de juin, un médecin que je connais depuis plus de vingt ans m’attends et me rédige le dit certificat. Le temps le presse mais il le prend tout de même, il m’explique qu’un nouveau dispositif pourrait me faciliter la vie et est pris en charge depuis le printemps. Il semble surpris, à moitié me connaissant, que je n’en sache rien.
Je repars avec le certificat et une ordonnance, prenant l’escalier je marque un temps d’arrêt au 3ème étage. Service pédiatrique. J’ouvre la porte, comme à chaque rare fois que je viens ici. Je regarde rapidement, comme à la recherche d’une madeleine au goût étrange, un recueillement face au temps qui est passé.
Je sors de la pharmacie avec un tas de boîtes jaunes. Il fait beau et l’été s’est déjà installé à Lyon. Arrivé chez moi je vide les boîtes, trie le nombre incroyablement inutile de carton qui n’emballe plus personne et m’apprête à faire la connaissance de « dispositif ».
Je tombe la chemise sans préliminaire, prépare le bidule, décapsule la languette du machin et…
Heu ? C’est quoi cette aiguille ? Là ?
Mince je suis dans ma cuisine à regarder ce truc qui ne me fait plus le moins du monde envie et je me dis « Bien joué, dans le truc de démonstration on ne voit pas l’aiguille ! ».
Aïe, bande de c…(bip) vous auriez pu la faire plus courte ! Je n’ai pas les biceps d’Arnold avec mes 58 kg !
Le premier contact passé avec la douceur d’un coup de pied où je vous laisse l’imaginer, la suite a été tout aussi charmante. La précision du capteur qui reste collé à mon bras deux semaines durant est pour le moins aléatoire. En plus, si cette (im)précision suit effectivement une logique, celle-ci n’est documentée ni expliquée nulle part.
Je fouille à la recherche d’info : notice ? Nada, site du fabriquant ? Ha faut que je m’inscrive pour la garantie. D’accord. Je dois faire une formation en ligne ? Peut-être que j’y comprendrais mieux ce truc ?
Je regarde une sorte de mi-chemin entre MOOC et vidéos sur YouTube à ma pause déjeuner. J’ai l’impression d’être pris pour un enfant et, encore…
Des couleurs flashies, une sensation bizarre. Je ne suis pas dans mon assiette. Ces personnages de dessins animés, tout sourire c’est étrange. Ça me dérange. Je ne sais formuler pourquoi. Mais ça me dérange.
Puis c’est quoi ce bouton « acheter en ligne » ? Depuis quand achèterait-on, en France, des dispositifs médicaux hors prescription ?
Puis toutes ces couleurs… Tous ces sourires…
Je passe de sites internet en sites internet, de sourires béats en déclaration d’amour aveugles.
Je découvre ainsi un autre monde. Un monde où l’on déclare sa flamme en même temps qu’une peur quasi irrationnelle de ne pas avoir le précieux capteur associé au dispositif à temps. Un monde où chaque jour vécu autrement qu’avec ce dispositif est devenu un enfer et son fabriquant un ange maudit à l’oreille dure. Des qualificatifs étranges aussi, de merveilleux à « totalement addictif grâce à l’application (…) ».
Une peur pour soi, son enfant, son conjoint ou parent.
Mince alors ! J’ai dû rater un train. On parle aussi de « type » 1, et 2.
Bizarre, je pensais qu’il y avait trois marches sur les podiums et puis, c’est quoi ces numéros ?
Ou alors j’ai carrément raté le lancement d’Apollo XI ?
Un jour en août 2018 – Réminiscence, encore…
Comme souvent je vais nager en fin d’après-midi. La piscine est en plein air sur les quais du Rhône, un bel exemple d’architecture et d’aménagement. Cela fait quelques semaines déjà que j’ai essayé divers modes de fixation pour maintenir le capteur.
Ce jour-là, je teste un nouveau montage bicouche : un pansement passablement hydrophobe surmonté d’un film hydrorésistant sur une bonne partie de mon bras. Je nage, le crawl, pas si lentement que cela ce qui fait que la protection n’a rien d’un luxe pour le si précieux capteur.
D’autant que je compte bien nager une heure entière, comme d’habitude. Après quelques longueurs seulement tout le montage se décolle. Ce jour-là je n’ai pas d’autre pansement en secours. Arrivé au bout de la ligne je jette le pansement décollé de rage sur la berge sous le regard étonné du maître-nageur.
Je ressens une colère sourde d’une intensité dévastatrice, sans la comprendre tout de suite.
22 ans, déjà ?
Ce serait un enfer que j’aurais vécu ?
Je m’assois, l’adhésif du capteur a dégusté parce que, oui n’en déplaise au fabriquant, le crawl ça brasse pas mal… Le soleil me sèche, le bruit de la ville assoupie sous une chape de plomb à laquelle elle refuse de s’adapter résonne contre les murs extérieurs.
C’est la première fois. La première fois que je pense ou repense à tout ça, que je comprends que ce que j’ai intégré comme réflexes relève d’un conditionnement.
Que, visiblement, ce conditionnement peut rendre malade, dingue peut-être, plus qu’une quelconque maladie elle-même.
C’est surtout la première fois en plus de vingt ans que je me trouve obligé, contraint, soumis même à un objet présenté comme révolutionnaire. Un progrès énorme est-il dit. Un progrès qui m’empêche de faire ce que je veux, ce que j’ai l’habitude de faire là et maintenant.
Je perçois comme une sensation de déjà-vu. Je réalise que j’ai dû réussir un drôle de « challenge » : celui d’avoir une pathologie qui nécessite qu’on pense à elle en quasi permanence, qu’on se connaisse sur le bout des doigts, qu’on change et adapte un traitement d’un jour sur l’autre, d’un repas à l’autre, d’une pinte de bière à une autre en naviguant entre pifométrie, tableau initialement destiné aux aficionados des régimes et recommandations douteuses de nutritionnistes en mal de notoriété sinon d’académisme.
Que j’y suis parvenu d’une drôle de façon : en me tenant à distance des médecins et de leurs disciples, en me trompant, souvent. Et, à chaque fois, en faisant connaissance avec le néant.
Et, ce jour-là, face à moi à quelques mètres se trouve une gamine d’une dizaine d’année.
Une impression de déjà-vu… Est-ce que je me souviens ? À quoi ressemblait-elle ? Entre dix mille je la reconnaîtrais mais je suis pourtant incapable de me souvenir…
La DeLorean démarre…
Juin 1993 – A long time ago
Je suis un écolier de 7 ans dans une classe d’une petite école de haute Corrèze. Timide, réservé voire introverti mais semble-t-il pas trop bête quand il ne s’agit pas de se mesurer à la conjugaison d’un subjonctif imparfait. Avec un côté MacGyver qui d’ailleurs ne m’a pas vraiment quitté. Timide mais aussi occasionnellement bouc-émissaire et souffre-douleur de mes petits camarades de l’époque.
Rien d’extraordinaire en fait.
En ce mois de juin nous participions à un échange avec des correspondant.e.s de Charente-Maritime et nous leur rendions la politesse de les accueillir chez nous après qu’ils aient accueilli des élèves de notre école chez eux. Mes parents ont une grande maison et dans ce groupe il y avait une jeune fille de 10 ans qui était accompagnée de sa mère qui devait être hébergée avec elle, nous avons accepté : pour nous que ce soit un, une, deux ou trois revenait peu ou prou au même. Dans ce bout d’Auvergne découpé par la Dordogne l’hospitalité ne se négocie pas. Elle s’appelait Aude, je m’en souviens car c’était la première fois que je rencontrais une « Aude ».
Mes souvenir sont partiels, il faut que je vous dise.
Il faut que je vous dise une chose que je n’ai jamais dite, écrite ou formulée aussi clairement : je n’ai aucun souvenir vraiment clair d’avant mes 10 ans. Après oui, beaucoup plus. À partir de 10 ans j’ai des souvenirs complets, des images avec leurs sons, leurs odeurs parfois même. Mais, surtout, avec leurs émotions. Je n’ai donc de souvenirs émotionnels, heureux ou malheureux qu’après mes 10 ans.
Avant cela je n’ai que des images, parfois des sons/paroles mais que rarement des émotions. Mais ces quelques jours de juin 93 font exception comme ces rencontres fortuites que l’on fait adulte et qui nous amènent à voir le monde différemment en nous obligeant à nous regarder nous-mêmes.
Aude a 10 ans d’ailleurs et sa mère l’accompagne, elle s’est jointe aux instituteurs pour les aider à encadrer les enfants mais, surtout, on me dit qu’elle est là car Aude est malade.
« Malade » ? Ah bon, mais de quoi ?
On me dit, mes parents je pense mais je ne me rappelle plus, qu’elle est « diabétique » et qu’elle a des piqûres chaque jour.
Quoi, tous les jours ? Oui, c’est grave mais ça se soigne. Et sa maman l’accompagne pour ça, elle lui fait ses piqûres. L’air de rien ça m’impressionne un brin parce que, à cet âge, l’épreuve pour moi était ces fichus vaccins qui nécessitent une piqûre.
Je me souviens simplement des journées passées ensemble, et j’étais heureux d’avoir un enfant de mon âge avec qui jouer dans cette immense maison mon frère ayant alors 3 ans. Je me souviens d’elle jouant dehors, de l’odeur du printemps, de son attirance pour les chats, des parties de différents jeux, son excitation devant un devers encore enneigé au sommet du Sancy où nous autres gamins avons tous et toutes usé nos pantalons faute d’avoir de quoi se faire des luges.
Le matin et le soir, avant de manger, Maud et sa mère s’isolent dans leur chambre à côté de la pièce où nous passions le plus clair du temps à jouer ensemble. J’ignore si on me l’a dit ou si je l’ai compris mais je savais que cela avait à voir avec ces « piqûres », je ne lisais pourtant aucune peur sur le visage d’Aude alors que cette simple idée me terrifiait. Je ressentais tout un continent de non-dits dont je ne savais rien et, passant plus tard devant la chambre dont la porte était restée ouverte je percevais comme un mystère et le vague souvenir d’un matériel d’injection posé sur le lit. Un flacon à liseré bleu et un autre à liseré jaune.
Un jour que nous visitions le barrage hydraulique de Bort-les-Orgues je me retrouvais être malmené par des garçons plus âgés. Je ne sais plus pourquoi. Je me souviens juste d’Aude qui s’interpose d’une main et quelques phrases. Lesquelles d’ailleurs ?
Jusqu’alors les représentations que j’avais du courage était adultes et, même souvent, masculines. Maintenant je me souviendrai d’elle comme n’ayant jamais peur de s’interposer. J’ai le vague souvenir de sa mère discutant avec mes parents du diagnostic, la façon dont cela s’est passé.
Je sais aujourd’hui que cette discussion a eu lieu mais qu’elle a basculé au fond de mon inconscient. Une histoire de soif, d’envie pressante, de perte de poids et d’énergie.
Février 1996*
C’est les vacances d’hiver et je retrouve ma tante à côté de Paris à Pierrelaye où mes grands-parents m’accompagnent. Je ne suis pas au mieux de ma forme mais je mange bien. Je ne grandis plus depuis quelques mois déjà mais je me sens bien et ne me rends compte de rien de particulier… Encore.
Mai 1996
Les vacances de printemps sont passées. Je n’ai jamais, alors, été bon en sport mais à l’école dès qu’il y a sport c’est l’enfer. J’ai l’impression de ne pouvoir avancer, courir sans m’épuiser. Je ne joue plus au foot ou à la balle au prisonnier depuis plusieurs mois sans vraiment m’en rendre compte.
Cela commence à faire quelques semaines que j’ai soif et me lève la nuit pour aller uriner. C’est subtil et n’arrive pas en un jour alors je ne me rends pas compte tout de suite qu’il y a un problème, mes parents non plus… Enfin, c’est ce que je pensais mais ils comprennent et ont peur bien avant moi…
Jeudi 6 juin 1996 – Si l’enfer est sur terre ce jour fut mon Purgatoire (et Dante loin du compte)
Rien ne va depuis deux semaines, j’ai soif en permanence à tel point que je ne sais même plus ce que c’est que n’avoir pas soif. Je bois, tout ce que je peux**, limonade, eau citronné, eau, jus de fruit, eau, encore eau, eau gazeuse ou plate. À 10 ans je me spécialise dans l’art d’étancher sa soif à la façon d’un Saint-Exupéry échoué dans le désert libyen.
Et je pisse, évidemment, tout autant. Je ne m’en suis pas rendu compte mais mes pantalons sont devenus trop grands, je ne faisais pas attention à ça mais mes parents si et ce jour-là nous allons voir le médecin.
Il est midi, son cabinet ferme à 12h30 et nous passons en dernier. Je me souviens qu’il m’examine, choses habituelles : pouls, respiration et… Il veut me prendre une goutte de sang et que j’urine dans un gobelet… ? Je suis un peu douillet et résiste pour la goutte de sang, on commence par l’urine, ma mère reste avec lui.
Que se sont-ils dit à ce moment-là ? Quelle a pu être la densité des silences et le poids des doutes dans cette pièce durant mes quelques minutes d’absence ?
Je reviens avec le gobelet, le liquide est clair, chose habituelle depuis plusieurs semaines, et Christian (le médecin) le note. Il y place une « bandelette » qui se transforme alors en guirlande. Mais une drôle de guirlande électrique qui aurait deux ampoules qui brilleraient infiniment plus que d’autres dans des tons vert-bleu et mauve-marron.
Mes urines sont gorgées de sucre, il parle d’acétone aussi. Il faut qu’il vérifie quelque chose avec une goutte de sang et, à ce moment-là, je n’ai jamais eu ni prise de sang, ni hospitalisation, ni… ? Heu ? À part les rougeoles et rhumes rien, en fait.
Il fait son truc avec un appareil étrange (Un One Touch, en fait), il me pique le doigt et ça fait mal mais moins que ce que je craignais : à l’époque la moindre blessure, le moindre vaccin est une épreuve pour moi… Et surtout pour celui/celle de mes parents qui m’accompagne…
Un chiffre apparaît sur l’écran de l’appareil : 253, Christian traduit : deux grammes cinquante-trois de glucose par litre de sang. Je suis assis à côté de ma mère et je me souviens m’imaginer ce grand bol doseur d’un litre avec à peine un demi-morceau de sucre (5 g) dedans et me dire que c’est foutrement, ridiculement peu… D’autant qu’avec mon gabarit du jour je n’ai même pas le contenu d’une cannette de soda dans les veines… C’est ridiculement peu, non ?
Christian explique qu’il faut vérifier ce résultat par une prise de sang et qu’il faut en refaire une après le repas vers 14-15h puis une autre à 17h.
Ai-je pleuré ?
Ai-je pleuré à cet instant-là ? Je comprenais que j’allais avoir trois grosses piqûres dans l’après-midi, je me souviens la peur, indicible pour moi à ce moment-là.
Mais ai-je pleuré ? Je ne m’en souviens plus…
Christian appelle le labo. C’est une petite ville, tout le monde se connaît, en même temps qu’il parle au téléphone, il rédige l’ordonnance et explique que nous arrivons tout de suite (le labo est à 600 m mais fermé depuis un quart d’heure). Il insiste sur le fait que je dois manger, normalement, comme je le ferais d’habitude sans réduire quoi que ce soit. Dans ma tête je repense au demi-morceau dans le bol-doseur rempli de sang et à la canette… Sérieusement, c’est ridicule d’en avoir si peu alors qu’on s’enfile si vite une de ces canettes ?
Non… ?
Je sens, ressens, l’urgence. Une urgence que je ne comprends pas. Nous allons au labo, on me fait ma première prise de sang, on remonte en voiture pour rentrer à la maison : je n’irai pas à l’école cet après-midi à cause des prises de sang. Je regarde la vallée s’éloigner par la fenêtre. Pendant ce temps, dans ma tête, ma survie commence à s’organiser.
J’en suis au déni qui négocie.
Je comprends que, bordel, 253, c’est trop. Que, si c’est trop, c’est que c’est peut-être… Non !!! Ça ne peut pas être ça ! D’ailleurs je ne mange jamais de bonbon ! Ni ne bois de canette, Aude non plus, mais non c’est autre chose… Dans ma tête de gamin de 10 ans la lucidité et l’imagination se livrent un combat d’une violence inouïe.
Pour que je ne sombre pas… Et je ne m’en rends même pas compte.
Nous arrivons à la maison avec ma mère, je crois que ma mère appelle mon père. D’habitude celui-ci rentre manger le midi mais pas cette fois… Je ne comprendrai que plus tard qu’il n’a pas déjeuné ce jour anticipant le pire pour partir plus tôt du travail.
Je mange et bois, de l’eau, toujours beaucoup d’eau. Je sens une chape de plomb, une épaisseur dans l’air, une espèce d’écho partout. La seconde prise de sang se fait à domicile, je crois, je ne m’en souviens plus. Mon cerveau devait turbiner un peu trop… Mais je suis conscient, d’ailleurs je ne perdrai jamais conscience en fait.
L’après-midi est bien entamé, mon père est là et nous descendons en ville voir Christian, avant ça on passe au labo, troisième prise de sang, on dépose mon frère chez mes grands-parents. Enfin, je crois, car je n’ai aucun souvenir de certaines parties de cette journée…
Nous sommes le six juin, c’est une journée que l’été dispute au printemps. Le soleil brille, j’ai l’impression d’être au milieu d’un immense désert, l’impression que les façades, les prairies, les arbres brûlent sous un soleil saharien… On arrive au cabinet de Christian, il est blindé et il y a peut-être 6 ou 7 personnes devant nous. Je m’assois dans un coin au bord de la fenêtre, j’ai soif, le soleil, cette lumière qui brûle tout…
Christian apparaît à la porte et son patient sort, il me voit et nous fait signe de rentrer.
Dante, salopard, si tu n’avais pas écrit le purgatoire je te jure que je l’aurais mieux écrit que toi car contrairement à toi pauvre mortel j’y suis allé.
Et c’était fort commun comme lieu !
Je sens l’urgence, encore, car nous ne faisons pas la queue comme d’habitude, nous entrons, il appelle le labo, cela ne fait qu’une demi-heure que nous y étions mais il demande les résultats. Là, maintenant, un silence, une attente durant laquelle nous nous asseyons.
Les résultats tombent : 4,05 ou 4,50g/l pour la deuxième, un peu moins de 6 g/l pour la dernière. Je repense à ce bol doseur et me dis qu’à présent il y a un morceau entier dedans… Je trouve encore cela ridiculement peu…
Mon imaginaire et ma lucidité se livrent combat entre eux et le verdict qui tombe scelle l’issue de la bataille. Mon imaginaire vient d’être terrassé par celui qui, ce jour-là, me sauva la vie. Je suis dans ce cabinet et j’écoute. À moins que j’entende.
Je suis diabétique, il n’y a pas, plus, de doute possible. Le traitement nécessitera des injections quotidiennes d’un produit qu’il nomme « insuline » mais il faut que je sois hospitalisé pour « stabiliser ma glycémie » et mettre en place un « protocole de traitement ».
Là, je pleure, je serre les dents et ma soif se nourrit de mes larmes. Je… Quoi ? Où ? Hôpital ? Tulle ? C’est loin Tulle, 1h20-30 de route, Christian appelle, encore l’urgence, ce n’est pas demain c’est maintenant, ce soir, qu’ils nous attendront, il faut y aller au plus vite. On nous a expliqué, la soif, les urines. Faute de mieux je bois… De l’eau encore de l’eau… L’urgence…
Qu’est ce qui se passe, pourquoi est-ce si urgent, tout ça ? Je vais bien moi, je ne suis pas dans mon assiette mais, bon, je n’ai pas l’impression d’être à l’article de la mort non plus***… Qu’est-ce qu’ils m’en…quiquinent tous ceux-là !?
On sort du cabinet, souvenir très précis, je sors debout, toujours debout, sur mes deux jambes, jamais je ne perdrai connaissance mais, putain Dante, qu’est-ce que j’aurais aimé me dissoudre dans une hallucination de ton fichu purgatoire amoureux !
Le temps s’effondre, je me retrouve projeté dans un présent d’une intensité sans nom qui dissous passé, futur, perspectives et espoirs.
Je suis en état de choc.
On sort du cabinet, je pleure à grosses larmes et ne contrôle plus mes larmes, les gens devant qui nous sommes passés semblent étonnés ou choqués, je ressens quelque chose qui ressemble à un mélange de honte et d’envie qu’on se soucie de moi. Quoi qu’ils aient ce ne peut être pire. Durant des années j’ai repensé à cette scène me disant que ce jour-là j’avais dû faire un sacré tort à Christian. Faut dire : qui a envie d’aller chez un médecin de chez qui les enfants sortent en hurlant de pleurs ? Parce que oui, je hurlais là… Ou peut-être pas, mais intérieurement je hurlais.
Il y a une supérette, mon père achète de l’eau plate et gazeuse, on remonte à la maison pour me préparer un sac avant d’aller à l’hôpital, là-bas… Tulle… J’y suis né mais je n’y étais jamais retourné, c’est presque un autre monde et je ne sais alors pas à quoi ressemble cette ville. Je suis un gamin de la campagne qui, quelque fois, monte à Paris et arpente à pied la capitale la découvrant au travers des yeux de son grand-père.
Je bois… Cette soif, est-ce que Saint-Exupéry avait idée de la précision de ses mots lorsqu’il décrit sa soif dans le désert libyen**** ? Contrairement à lui j’ai de quoi l’étancher ou, plutôt, essayer car cela fait déjà plusieurs semaines que c’est peine perdue et que j’ai soif même en buvant…
Je sors de la voiture devant la maison, mes parents préparent mon sac, je ne sais plus ce qui, comment, qui, quoi…
Je vais dans le jardin qui, à l’échelle de mes dix ans est immense, l’herbe n’est pas coupée et avec le soleil qui arrose cette terre gorgée d’eau elle me dépasse. Au lieu de tondre totalement mon père y fait des chemins que j’arpente en ayant l’impression de parcourir un labyrinthe entre ces hautes herbes, m’amusant à les traverser pour me cacher ou prendre un raccourci. Je parcours un de ces chemins qui passe, alors, derrière des charmes. Je me souviens de l’odeur de ces herbes, du soleil qui semble tout brûler autour de moi, ma main dans les herbes…
Souvenir très précis : le soleil commence à s’incliner à l’Ouest et je lui fais presque face, les graminées et l’oseille sauvage caressent mes mains, l’achillée mille-feuille, et le soleil disperse ses rayons dans les branches torturées des charmes…
J’ai dix ans, je prends tout. Tout ce que cet instant a de vie à mes yeux.
Je prends tout, chaque sensation, image, odeur… Je prends le printemps et l’été dans le même instant, le renouveau et l’explosion, l’enfer et le paradis, ces arbres, ce jardin, c’est chez moi et j’imprime au plus profond de mon âme ce lieu et cette vie.
Car, à ce moment-là, j’ignore complètement si je reviendrai tellement la peur irrigue mon cœur. J’ai dix ans et je regarde la mort. Ma mort qui n’était jusqu’alors qu’une idée en face et je prends tout.
Tout ce qu’il y a de vie devant moi.
Mais ce n’est pas ce que je dis à haute voix, car je parle tout seul et je ne dis qu’une chose : je reviendrai. J’ignore quand, j’ignore comment ou dans quel fichu état mais je reviendrai !
Et je reviendrai toujours là où l’on m’attend, là où j’aime être.
Et maintenant il faut aller à Tulle, à l’hôpital. Il fait chaud, je bois beaucoup mais… Là, ce n’est plus pareil, je ne sais si c’est à force de pleurer. Mais, la soif… La soif n’a plus le même goût…
Ne pas sombrer, mon père conduit, ma mère me tient éveillé. Je suis derrière et je regarde, je m’assoupis, on me réveille. Aucun souvenir de ce trajet sauf en arrivant à Tulle, l’hôpital me semble gigantesque, on passe à l’accueil, on monte au 3ème, service de pédiatrie où nous sommes attendus, tout va vite. Si vite…
Ce goût, putain ce goût*****… Je sens que je m’engourdis un peu mais… Non, ça va et puis seul le présent existe, la prochaine étape, que va-t-il se passer ? Comment ? Quoi ? Pourquoi ? En dehors de la pièce où nous sommes, rien n’existe plus pour moi. Mon imaginaire vient de mourir et mon cerveau est en prise directe avec le réel et le présent.
Putain que c’est chiant ! Je tourne en rond dans une salle d’attente au 3ème étage. Mes parents, les pauvres, sont dans un état à peine meilleur que le mien. Mon attention se fixe sur le moindre élément susceptible de me ramener à la vie et je cherche des visages familiers dans une foule d’inconnus, je découvre des sons, odeurs, machines dont j’ignorais l’existence. Le visage d’un gamin que je connais apparaît, ma mère discute avec la sienne, je me rattache à cette image qui donne de la profondeur à mon présent, je ne comprends ni ne me souviens de ce qu’elles se disent mais écouter distrait mon esprit quelques instants…
Je ne sais même plus quelle heure il est mais, visiblement, nous sommes en retard pour le dîner.
Deux médecins arrivent, l’un jeune est endocrinologue, l’autre pédiatre est plus âgé. Nous allons dans une salle où l’on me pèse, ils reprennent mes résultats, j’entends parler « dose », « pompe », « surveillance », je suis allongé sur un lit et l’infirmière en chef est là, Marie-Claude. Dix ans plus tôt c’est elle qui dans un autre service s’était occupé du nourrisson que j’étais. J’ai l’impression que des boucles se font et défont, je suis toujours en prise directe dans le présent. Il ne me reste qu’une crainte qui se concrétise : qu’on me mette une perfusion, ce truc qui reste dans le bras avec cette aiguille qui me semble ENORME… Pas de chance, il faut me réhydrater et me faire passer l’insuline en IV. Jackpot, j’en aurais deux pour cette nuit…
Ils nous expliquent que j’ai un diabète insulino-dépendant, qu’il existe un traitement, que je pourrai très bien vivre avec en faisant quelques adaptations. Non, pas de régime (réponse à une question de qui ?) mais il faudra absolument que je mange équilibré en contrôlant les quantités mais il n’y a pas d’interdit absolu. Les deux médecins insistent sur le fait qu’il n’existe pas d’alternative à l’insuline et qu’en aucun cas je ne devrai jamais l’arrêter.
Jamais… Toute sa vie, toute ma vie, toute la vie j’aurai des injections… La recherche ? Ils font des progrès, il n’est pas exclu que dans 10 ans on puisse guérir ce diabète de type 1 mais il faut ménager le corps et prendre soin d’éviter d’importantes variations de ce qu’ils nomment « glycémie » et qui semble se mesurer au bout du doigt…
Mes parents sont effondrés, tous s’embrouillent, on me place dans ma chambre d’hôpital où j’ai la chance d’être seul, mes parents sont là et on me met les perfusions.
Je pleure, je hurle… En fait je pleure mais je ne sais même plus si j’avais encore la force de résister, je crois que si car je me souviens qu’on m’a tenu…
C’est qu’il ne se laisse pas abattre le Matthieu !
Une machine avec une ééénormeee seringue m’injecte un produit nommé « insuline » dans le bras droit pendant qu’une bête perfusion me réhydrate dans le gauche… On me sert à manger et on m’explique qu’une infirmière va venir toutes les heures jusqu’au lendemain matin me faire une glycémie « capillaire ».
Sans rire, je pensais que ce mot était réservé aux cheveux ! Et puis, Dextro ? C’est quoi ? Ca se mange ?
Je suis ravi ! De toute façon on m’aurait expliqué que la fin du monde eût été dans cinq minutes je crois bien que ça m’aurait totalement indifféré.
Bon, j’aurais demandé pourquoi et comment. Il ne faut pas déconner non plus ! (J’ai eu la chance immense que les équipes répondent à mes questions du premier instant à mon départ.)
Du vendredi 7 juin au dimanche 16 juin 1996 – L’enfer, c’est surfait, et du purgatoire on ne revient que pour vivre. N’est-ce pas M. Alighieri ?
La nuit a été longue et entrecoupée toutes les heures par ce qu’ils appellent « Dextro » (visiblement non comestible ☹). On me dit que « ça » baisse, je ne me souviens plus des chiffres mais la soif… Je n’ai plus soif ! Je suis complètement exténué par le manque de sommeil, l’état de choc, mais je me sens… Tellement « mieux ». J’ai l’impression, en plus d’être figé dans ce présent où mon état de choc me fixe, de ressusciter******.
Je ne peux bouger de mon lit et doit uriner dans un truc en plastique. Je râle et veux sortir de cette pièce. Je me sens tellement mieux !
Il faut alors commencer à m’expliquer les choses et puis je ne suis pas encore tiré d’affaire, il reste un protocole à trouver… Le soir on m’enlève la perfusion de physio et le lendemain on remplace la machinerie à piston collée au sol par une plus petite qu’ils appellent « pompe ».
Je me souviens me demander ce que c’est ce bidule « pompe » et trouve totalement absurde de nommer un appareil qui injecte en continu une substance « pompe ». Mais le samedi je peux à nouveau bouger et sortir de ma chambre. Alors vive la « pompe » qui perfuse mieux qu’elle ne pompe !
Je reprends contact avec le monde, et la vie, ainsi qu’un certain nombre de joyeusetés qui deviendront mes compagnons d’infortune à l’étymologie hellénistique : hypo et hyper (-glycémie). On m’explique encore et encore le fonctionnement du pancréas, de l’insuline, la destruction des îlots de Langerhans par mon système immunitaire, que la recherche avance et que les traitements fonctionnent bien… Pourvu qu’on trouve les doses et se fasse ses piqûres.
« Pourvu qu’on… »
Il y a une pièce où l’on trouve des livres, quelques consoles et des jeux. L’hôpital étant à flanc de colline on peut même sortir dehors… Sentir le vent venant de l’Ouest et amenant l’orage de l’Atlantique… Je me passionne pour les écritures anciennes car il y a des livres de vulgarisation sur l’Egypte, les civilisations sumériennes. Je passe les jours à dessiner des glyphes et, je ne sais sortis d’où, mes parents m’offrent des tampons constituant un alphabet de hiéroglyphes (je suis ému car j’ignore les efforts déployés pour trouver ce cadeau à point nommé). Je joue à la console, elle n’est pas récente mais c’est une découverte pour moi. Mon esprit trouve des choses à quoi s’accrocher.
Par moment j’ai très soif et on m’explique que je suis « en hyper », qu’il n’y a pas assez d’insuline dans mon sang… L’hyper me fait très peur. Elle me renvoie à cette soif, à ce verdict, ce diagnostic. L’hypo se fait plus ressentir mais, à ce moment-là, je l’aime bien car on me donne un jus d’orange (que j’adore). Plus tard je comprendrai toute la perversité de cette dernière. 22 ans plus tard, sans m’en rendre compte lors d’une soirée, j’en boirai un verre et fondrai en larmes me souvenant que c’est, sans blague, la première fois que j’en rebois depuis… 20 ans.
J’apprends au passage que le pain et les pâtes sont « sucrés » comme les confitures, moi qui en avais alors fait la base de mon alimentation me voilà bien ! Entre autres idioties qui se disaient à l’époque on me dit de ne pas abuser des sucrettes à l’aspartame de crainte que je m’habitue au goût du sucre.
Ma pompe est remplacée par deux injections (Actrapid et Monotard/Novolin) chaque jour, je commence à bien connaître les hypos entre 10-11h et 15-16h.
À l’hôpital il y a un gamin, avec qui je passe mes journées et regarde des films les soirs. Son prénom reste pour ma mémoire un mystère mais son visage et celui de son père ne me quitteront plus. Un après-midi son père vient, je crois qu’il est là depuis un moment déjà. Je joue avec lui et son père vient le voir, le serre dans ses bras. On discute. Il me demande ce que j’ai (ou pour-quoi je suis là). Je me souviens lui répondre que c’est pour un diabète « insulino-dépendant » (DID), mes mots sont maladroits je n’ai pas encore l’habitude ou l’expérience pour en parler. Son père me répond, tout aussi maladroitement : « Au moins ça se soigne »… L’expression de son visage restera ancrée dans ma mémoire avec ce vertige infini… Que je suis sans doute chanceux.
Entre temps je vois une psychologue, je n’ai pas très envie d’y aller déjà que je vois plein de médecins la façon dont on me présente celui-là ne fait pas envie. L’entretien est expédié avec une violence sans nom. Je suis là en souffrance et celle-ci ne semble se préoccuper que deux choses : est-ce que j’ai compris et est-ce que mes parents ont une relation stable. Ma mère m’accompagne et aux questions portant sur mes parents j’indique que ma mère est plus à même de répondre. Elle coupe la parole à ma mère d’une façon totalement indigne. Comme j’ai mon caractère, l’air de rien, je bâcle l’entretien en lui dessinant quelques glyphes de mémoire n’ayant aucun sens mais lui en inventant pour qu’elle nous laisse partir plus vite. De cette expérience je garderai une méfiance pour les professions en « psy », méfiance injustifiée et heureusement démentie plus tard. Mais, dans ce cas, c’est de l’incompétence quasi-criminelle.
Évidemment je ne vais pas si bien, mes journées alternent entre fuite dans n’importe quel jeu, lecture qui me tienne loin de ce lieu et la confrontation brutale avec mon nouvel état. Mon nouveau « moi ». J’y pense un après-midi, je sens que je vais pleurer et je suis dans ce long couloir du service de pédiatrie. Accablé, exténué mentalement, je vois le soleil glisser lentement par une fenêtre au loin et les feuilles d’un arbre en pleine éclosion. Je pense à l’arbre, à sa sève qui fait bourgeonner ses feuilles, ses fleurs. Je pense à son histoire à lui, à son âge aussi. Je sais que les arbres vivent vieux, très vieux et je pense à tous ces printemps, ces étés, ces orages et tempêtes qu’il a traversés et traversera encore. Je réalise alors que, toute cette vie que j’ai pris avec moi avant d’arriver là, dans le jardin, toute cette vie existait avant moi. Existera après moi.
Qu’elle existe que je sois là ou non.
Et d’un coup je me sens mieux, je retrouve un futur et des bribes de passé. Ce jour-là, j’ai trouvé ce qui restera pour moi un « mantra ».
Le 16 ou 17 juin on quitte l’hôpital, un sac rempli de matériel d’injection, les dernières recommandations, des ordonnances.
Arrivé à la maison je me souviens être allé dans le jardin où, dix ou onze jours plus tôt j’étais allé.
Je suis revenu, heureux d’être là.
Simplement heureux d’être au monde, je ne pleure plus.
Un jour d’été 2001 – La force ne vient pas des capacités physiques ; elle vient d’une indomptable volonté. (M. Gandhi)
J’ai passé l’après-midi à faire du vélo. Vivant à la campagne je fais beaucoup d’exercice sans m’en rendre compte et cela a un effet bénéfique pour moi. Ce jour-là, comme toujours alors, j’ai été bien plus loin et longtemps que je ne le dis à mes parents. Mon tour de santé m’a fait faire plus ou moins 20 km avec quelques centaines de mètres de dénivelé. Le soir arrivant j’ai faim. Ma mère a fait un gratin de pâtes qui me fait (très) envie et le soir j’ai encore une injection d’Actrapid mais cette fois mélangée à de l’Ultratard. On discute avec mon père qui me fait l’injection et on ajoute deux unités d’Actrapid car je compte bien manger.
Le repas se passe bien, je mange comme un gamin de 14 ans qui a une faim d’ogre.
Je me mets sur le canapé et sens mon ventre. Un truc ne va pas. Un film passe à la télé qu’on regarde ensemble mes parents et mon frère. Je commence à transpirer et ma vision se trouble, mon père m’allonge. Je suis incohérent, ma glycémie indique un joyeux 0,4… Mais ce n’est ni « comme d’habitude » ni… Logique ?
Ma mère amène du jus de fruit et des sucres, et encore des sucres. J’ai la nausée, on me gave de ces liquides sucrés et le goût de sucre envahit ma bouche.
Rien n’y fait, ma glycémie plonge : 0,35 – 0,3… Je suis conscient, j’avale tout ce qu’on me donne et je sens que ça ne tourne pas rond. Mon père me retourne et je vois cet étui orange de glucagon, il prépare l’injection, ma mère appelle un médecin (de garde, c’est un samedi soir). Je me souviens la brûlure dans une fesse et cette nausée… Ma glycémie fait l’hélicoptère en sur-place et j’use mes forces à rester conscient.
Toujours rester conscient. Mon frère est là du haut de ses huit ans. Abandonné à lui-même. Faisant face à son impuissance à me venir en aide et constatant celle de nos parents, aussi.
Et sans doute, aussi, faisant lui tout autant que moi face au néant de me voir basculer dans un tel état en si peu de temps. Sur un bout de papier que je retrouverai des années plus tard, il note. Il note des chiffres, 0,4 – 0, 3 – 0, 35 – 0,3 – 0,4.
Le médecin arrive et, sans doute dans un souci de faciliter le diagnostic je vomis la totalité du repas, des jus de fruit et des sucres avalés. J’ignorais qu’un estomac pouvait autant contenir. La nausée ne cesse pas et j’apprendrai plus tard que le glucagon n’arrange pas la nausée. Le médecin comprend vite l’urgence et j’ai droit à ma première ampoule de glucose. Je ne contrôle plus mon bras droit qui reste suspendu en l’air. Je « joue » avec tâchant de le mettre à l’horizontale alors que celui-ci retourne à la verticale (je suis allongé). Mes parents et le médecin, compétent, comprennent que le glucagon n’a pu avoir qu’un effet limité.
J’ai sans doute carbonisé une grande partie de mes réserves hépatiques cet après-midi.
Première ampoule, sensation brutale de retour à la vie. Ma conscience émoussée s’affûte un peu mais ce qui me sert alors de cerveau reste en compote. Ma glycémie a meilleure mine et remonte à 0,5… Mais nous somme juste au « pic » d’action de l’insuline. La partie n’est pas gagnée. Mon frère notera toutefois dans une lucidité étonnante « ça remonte ».
« Ça remonte… » Deux mots, juste deux mots. Entre moi, allongé, épuisé, exténué, dispersant sans compter ce qu’il me reste de force à garder les yeux ouverts et le néant.
Le médecin, inquiet que ça ne fasse pas plus, fait une entorse salvatrice au protocole en me faisant une seconde ampoule de glucose. En effet, l’hôpital le plus proche est… Pas proche du point de vue d’une Actrapid bien « lancée ». Cette fois c’est bon 0,9 – 1 – je ne sais plus. Durant ce temps je ne cesse de vomir et on me donne de l’eau que je rends aussitôt. La situation se calme, je cesse petit à petit de vomir mais je suis épuisé.
Je ne sens plus mes extrémités depuis un moment déjà…
J’ai l’impression que mes abdominaux sont en plomb et… Je perds l’usage de la parole. Je veux aller me coucher, pas là mais dans mon lit, je n’arrive pas à le dire, mes parents me sollicitent pour que je leur parle mais aucun son ne parvient à sortir.
Je n’ai plus peur, le peu de conscience que j’ai encore après ce marathon comprend que, bien que je finirai un jour entre six planches… Bien ce ne sera pas ce soir ! J’essaie de m’extraire du canapé mais, à peine assis, je m’effondre au sol et rampe en direction de la porte. Je mime le fait de dormir. Le médecin les rassure : la perte de parole c’est transitoire et dû à l’hypoglycémie, cela ira mieux dès demain. Mon père me porte, à 14 ans je ne suis plus une plume mais il me dépose dans mon lit où Morphée m’étreint rapidement.
Le lendemain matin, au moment de me lever, voulant aller aux toilettes, j’ai dû parcourir les 6 mètres m’en séparant en rampant après avoir à peine réussi à m’assoir alors que, 12 h plus tôt, j’avalais le bitume sur mon vélo…
Même au pire des salopards je ne souhaiterais pas ce que j’ai traversé ce jour-là.
31 janvier 2011 – Réminiscence
J’ai bientôt 25 ans et j’ai fini mes études. Nous sommes un lundi et je suis réveillé un peu avant 8h par mon téléphone : N. C. m’appelle pour me dire que le poste à Lyon pour lequel j’attends une réponse depuis 4 mois ne sera pas ouvert. Il est navré et a appris la nouvelle le vendredi et ne pensais pas que me l’annoncer une veille de week-end serait très agréable. Il a raison, mais ça me fait bien chier, je suis au chômage depuis un mois et espérer ne pas passer des journées entre bagnole et train à passer des entretiens auprès de personnages qui, au mieux sont haut en couleur, au pire n’ont rien à dire et le plus souvent ne cherchent qu’à remplir leur CVthèque.
Cela fait quelques mois que mon père ne va pas bien, sans symptômes précis, Christian lui a prescrit un scanner de l’abdomen et, étant là, je l’accompagne avec ma mère. Nous arrivons à l’hôpital, injection du produit de contraste, la séance de scanner quelques minutes plus loin le radiologue arrive avec les résultats. Il les montre sur son écran et précise qu’il faudra des examens complémentaires mais qu’on y distingue des « formes ». Je m’approche de l’écran et je scrute chaque image, je mets en branle mon cerveau : je n’y connais rien alors je fonctionne par déduction et analogies. Et je distingue les tâches et, surtout, je vois clairement une différence entre droite et gauche, autour de ce qui ne peut être qu’un poumon et le cœur.
Que se passe-t-il alors ? Merde Matthieu, qu’est-ce qui t’arrive ?
Cette sensation…
Mon inconscient percute, mon conscient s’enfuit et fait tourner mon imaginaire à plein régime. Je turbine encore… Une impression de déjà-vu, quinze ans avant, ce mécanisme…
On remonte en voiture, je suis assis devant et ma mère conduit. Ma lucidité se bat avec mon imaginaire, une vieille chanson tourne en boucle dans ma tête « There must be some kind of way out of here »…
Je hoquette sur le siège passager tâchant de retenir un truc que je n’avais pas senti depuis longtemps et fonds en larmes.
On s’arrête, rien de grand n’est dit. Seules ces paroles de mon père et sa main sur mon épaule : « ne t’inquiète pas, ça ira »…
Un lundi début mars 2011 – Les hommes bâtissent des barrages et oublient que l’eau n’est jamais éternellement domptée.
Depuis ce scanner une biopsie a été faite dont nous attendons les résultats. Rien n’est clairement dit à mon frère, ce que je désapprouve en fait.
Mais la turbine dans ma tête m’empêche de prendre position. Christian appelle, c’est mon père qui décroche, quelques phrases sont prononcées et je fais les cent pas entre cette pièce et une autre. Je m’assois sur un fauteuil et mon père revient, je ne sais même plus quelle question j’ai posé mais il répond : c’est un cancer du poumon.
Je pensais avoir une idée de ce qu’un diagnostic peut avoir de brutal. Je croyais savoir ce que c’est que voir la mort, sa mort en face… J’ignorais totalement le ravage que cela est quand ça concerne une personne qu’on aime. Je sors dehors, mon père a compris que ça n’allait pas, que je « digère ». J’avance dans le bois derrière la maison, je sens des digues céder l’une après l’autre. Je sens des larmes, des vraies larmes, je sens la colère, la rage… Je hurle et frappe le sol alors que ma mère me trouve, elle m’étreint mais sait que je dois rester seul un instant. Je refuse que mon père me voie ainsi, je refuse d’être moins digne qu’eux 15 ans avant. Il y a une source à un petit km, j’y vais me laver le visage. Je titube dans cette forêt.
Des digues cèdent. Et cèdent, encore. Des barrages érigés par l’orgueil d’un gamin de 10 ans ne voulant ni mourir ni faire de compromis avec la vie volent en éclat.
Le gamin avait tellement bien bâti cette forteresse pour tenir tête à l’angoisse de sa perte qu’il n’avait pas pensé à celle de ceux qu’il aime. Il se sent bête et honteux de ce qui lui semble alors un orgueil démesuré.
Je m’allonge à même le sol et laisse les larmes noyer mes yeux.
Cela faisait 15 ans, quinze années que je n’avais pas – vraiment – pleuré.
* Ce souvenir est reconstitué, a posteriori, il est apparu qu’à ce moment-là les symptômes, bien que très et trop discrets, étaient déjà subtilement présents.
** Par une chance immense, même s’il y avait du soda à la maison, mes parents n’achetaient que de la limonade à l’édulcorant…
*** C’est une chance exceptionnelle que j’ai eue qui peut s’interpréter de différentes façons mais, quoi qu’il en soit, à quelques jours ou semaines près j’ai évité un coma et une situation bien plus précaire pour mon pronostic vital.
**** Terre des Hommes
***** Prenez votre haleine un lendemain de (très grosse) cuite, les arômes en moins, et vous y êtes.
****** « Unspeakably wonderful » auraient été les mots prononcés par la première états-unienne traitée par insuline en août 1922 à Toronto, Elizabeth Hughes Gossett. Elle pesait alors 20 kg à 14 ans.



 Frédérique Georges-Pichot
Frédérique Georges-Pichot
 Anne Durand
Anne Durand Juliette de Salle
Juliette de Salle




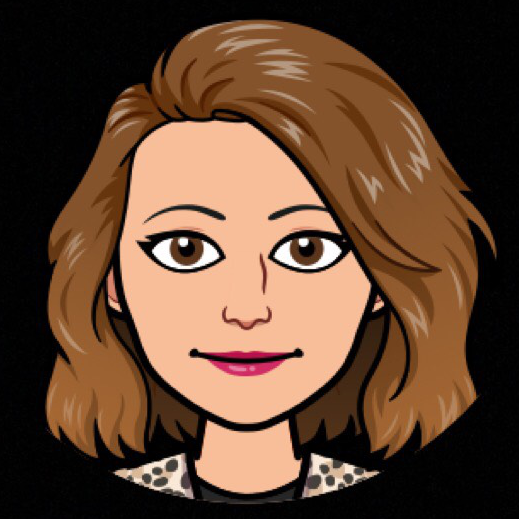














EC
Percutant ! Quand la poésie rencontre la violence des mots et des faits.
Matthieu de Mijolla
Merci Emilie 🙂